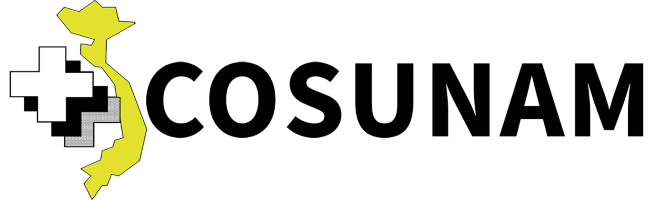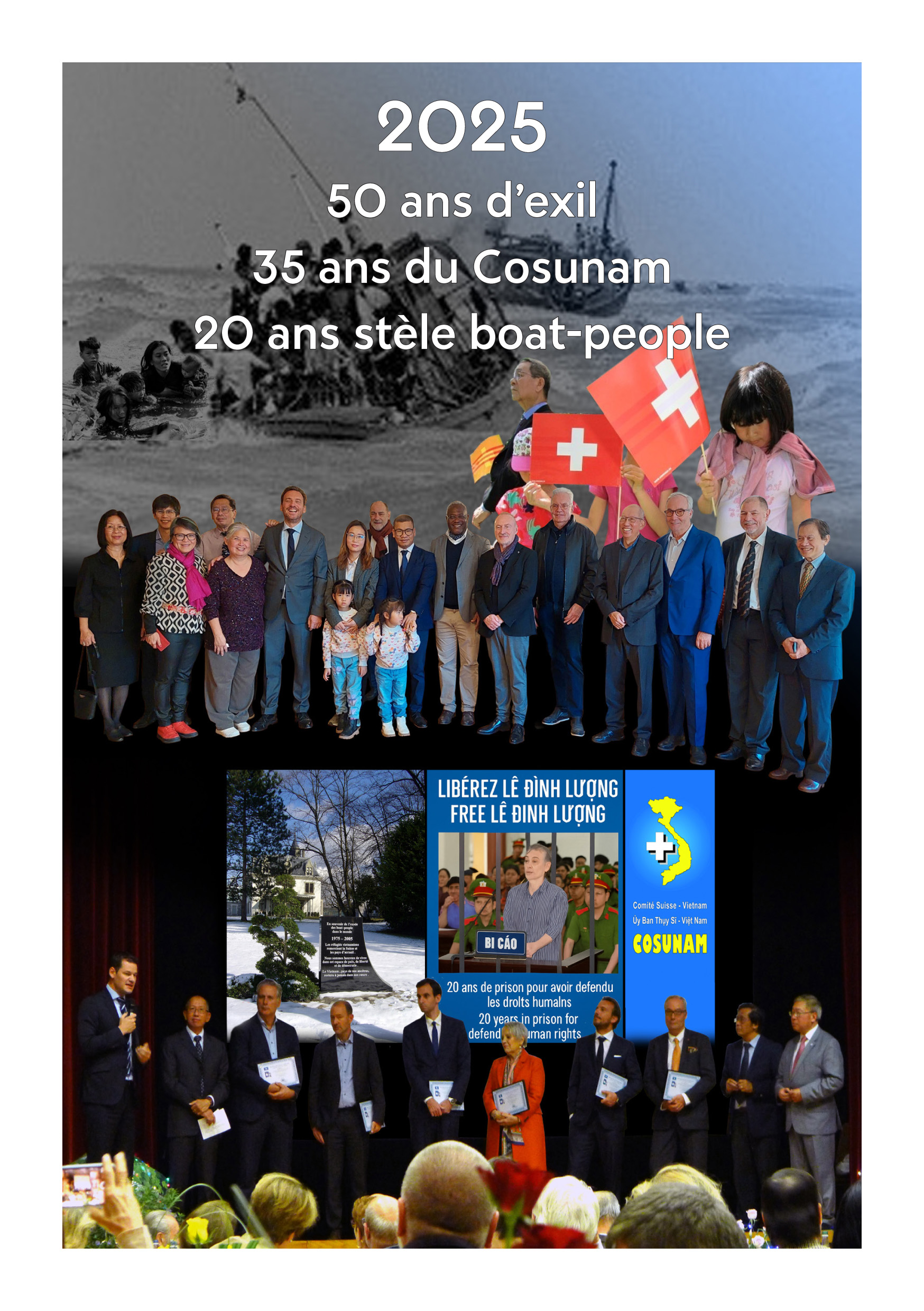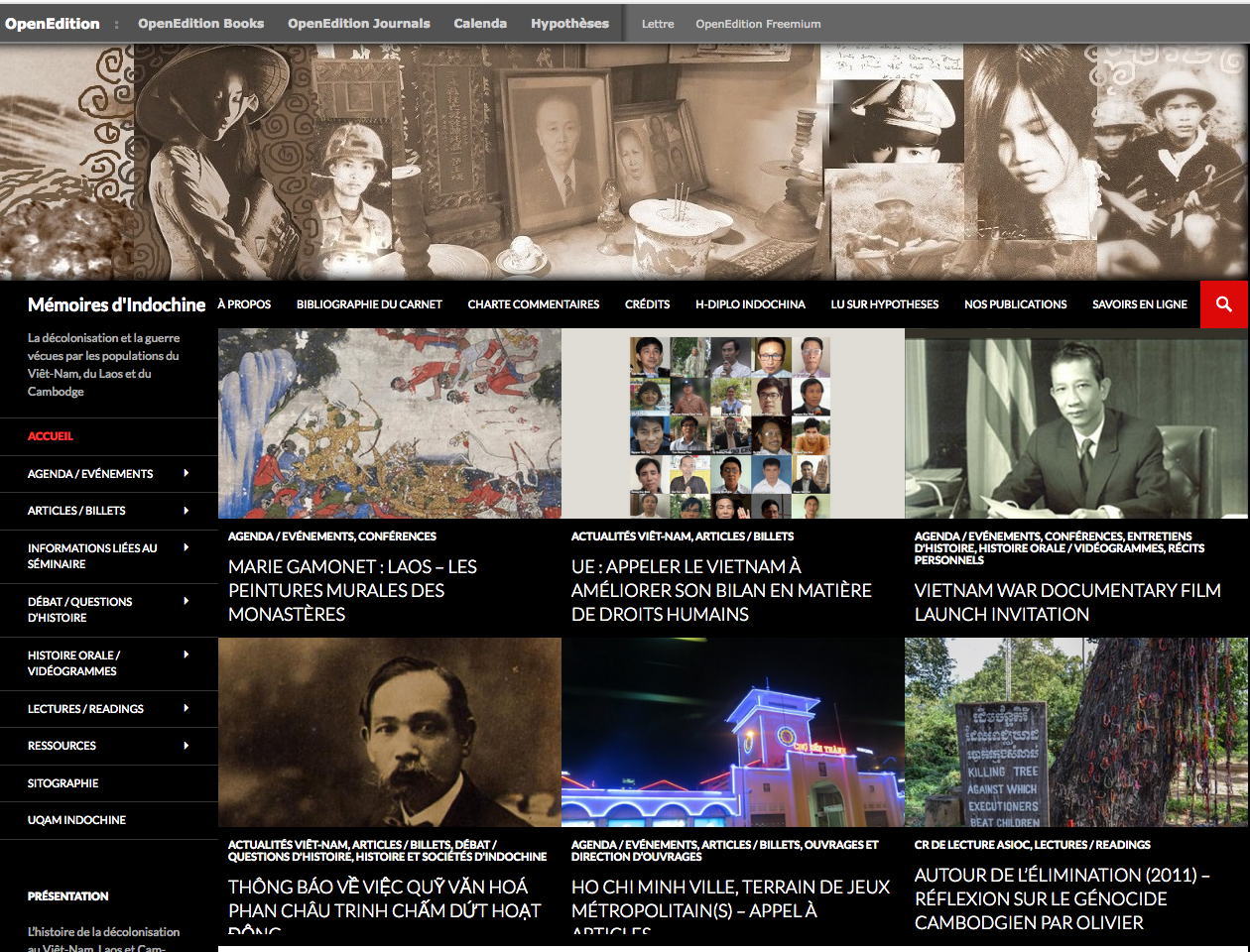Xuân et Sang Dao, histoire de boat-people en Suisse

Ils se sont rencontrés après leur fuite du Vietnam : Trong Sang Dao (43 ans, avec un couvre-chef typiquement vietnamien) et Xuan Dao (43 ans) vivent aujourd’hui à Neudorf. (Photo : Pius Amrein / Neue LZ)
C’est la dernière volonté de son père. La petite Xuan doit quitter le petit village du sud du Vietnam. C’est devenu trop dangereux pour la famille Tran depuis que les chars des troupes nord-vietnamiennes se sont emparés de Saigon le 30 avril 1975 et dominent le sud du pays. Les voisins disparaissent. Les propriétaires de maisons sont expropriés.
Seule sur un chemin sombre
Les Trans doivent cacher leurs biens pour échapper aux communistes. Le père tente à plusieurs reprises de fuir la terreur avec sa famille – à chaque fois, c’est un échec. Maintenant, après sa mort, la petite Xuan, âgée de neuf ans, doit quitter seule le pays. Une fuite en solitaire est moins dangereuse, comme l’a prouvé auparavant sa sœur de 15 ans son aînée. Elle a trouvé refuge en Suisse, où elle vit à Lucerne.
C’est le 29 juillet 1981, un jour de pluie, la mère emmène Xuan chez des parents dans un village au bord de la mer. Elle lui coud une bague en or et un papier dans son chemisier avec l’adresse de sa sœur à Littau. Xuan enfile le haut, un pantalon en jersey, une veste de pluie. La nuit est tombée. « Va-t’en maintenant », dit la mère. La fille obéit.
La fillette parcourt deux ou trois kilomètres, passe devant des champs, seule sur un chemin sombre. De la boue colle à ses chaussures. « J’avais une peur bleue », raconte Xuan, aujourd’hui âgée de 43 ans. « Moi seule sur un chemin sombre ; je ne pourrai jamais me débarrasser de cette image ».
Au point de rendez-vous, une maison de pêcheurs, Xuan monte dans un bateau. Elle l’emmène en mer vers un bateau plus grand. Les jours suivants, Xuan s’entasse dans la salle des machines avec une douzaine d’autres réfugiés – sa mère a donné au propriétaire du bateau une partie des économies de la famille comme billet pour le voyage.
La nourriture et l’eau viennent à manquer. Xuan chante des chansons et prie Dieu. Le septième jour, une femme donne naissance à un enfant, une centaine de Vietnamiens sont maintenant à bord – quelques heures plus tard, ils voient la terre. Une petite île en Indonésie. Au bout d’un mois, un bateau vient les chercher, les réfugiés sont placés dans un centre d’accueil sur une île plus grande. Xuan déchire l’adresse de sa sœur cousue à l’intérieur de son chemisier et la montre aux responsables du camp. Des mois s’écoulent jusqu’à ce qu’elle monte dans un avion et atterrisse à Kloten via Singapour.

Nous sommes en février 1982, Xuan aura dix ans dans trois semaines. Elle voit la neige pour la première fois de sa vie. « Je n’oublierai jamais ce moment ».
Ennemi dans son propre pays
À cette époque, Trong Sang Dao (43 ans), qui deviendra le mari de Xuan, est déjà dans le canton de Lucerne. Loin de la propagande communiste qu’il entend quotidiennement dans les haut-parleurs de l’école de la ville portuaire de Vung Tàu, à une bonne centaine de kilomètres au sud-est de Ho Chi Minh Ville, l’ancienne Saigon, lorsqu’il est enfant.
Son père est menuisier et militaire pendant la guerre en tant que soldat de l’armée sud-vietnamienne . Après la fin de la guerre, le père Dao reste vis vis du régime communiste un ennemi dans son propre pays.
Les premières années d’après-guerre, les Dao patientent. Lorsque de plus en plus d’opposants au régime sont envoyés dans des camps de travaux forcés ou dans des camps dits de « rééducation », la peur du communisme devient plus forte que la peur de mourir en pleine mer. Le père Dao et une famille de pêcheurs prévoient de s’enfuir ensemble dans un bateau. N’importe où, mais pas aux États-Unis. Mais pas dans ce pays qui a abandonné le Vietnam en retirant ses troupes.
Il préfère aller en Australie ou en Suisse. Trois de ses fils sont déjà arrivés à Sursee. Ils ont profité des contacts de leur oncle, qui s’est formé au sacerdoce à Fribourg dans les années 1960. Depuis, un coucou suisse est accroché dans la maison de Dao. Mais les projets des familles commencent à filtrer. Une fuite est désormais trop dangereuse. La prison menace. Les Dao repoussent leur départ du Vietnam.

Tempête et pirates
Une nuit, à la mi-juillet 1979, le père Dao saisit par le bras le petit Trong Sang, âgé de sept ans. Il l’emmène vers un petit bateau devant le port. Puis vers un cotre plus grand, d’environ 15 mètres de long et 4 mètres de large. Son frère aîné et quelques membres de sa famille l’attendent déjà. Cette fois, peu de gens sont au courant des projets de Dao. La mère et la sœur restent derrière – si quelque chose devait mal tourner, le père pourrait revenir avec les fils. Si toute la famille y allait, les communistes s’empareraient de la maison et des terres.
Le cotre motorisé s’éloigne de plus en plus en mer. Les Daos et les 80 autres Vietnamiens se laissent dériver sans but, sans carte, sans boussole. Une tempête se lève, Trong Sang a le mal de mer, les quatre premiers jours en haute mer s’effacent de sa mémoire. Le cinquième jour, quelque part dans le golfe de Thaïlande, cinq grands bateaux encerclent les réfugiés. Des pirates les dépouillent de leurs sacs de voyage, de leur argent, de leurs bijoux et de leurs provisions. C’est maintenant une question de vie ou de mort. Trong Sang prie.
Quelques jours plus tard, le bateau entre dans le port de Singapour. Les Vietnamiens reçoivent de nouvelles provisions et de l’eau – mais on ne les laisse pas débarquer. Singapour n’accepte pas les réfugiés, elle ne veut pas mettre en péril ses relations avec Hanoï. Un grand navire remorque le bateau de pêche vers la haute mer. « Des dizaines de cargos sont passés devant nous par la suite, mais aucun ne nous a acceptés », raconte aujourd’hui Trong Sang. « Les capitaines des bateaux ne savaient pas ce qui leur arriverait s’ils nous aidaient. Ils nous ont abandonnés à notre sort ».
Neuf jours après leur fuite, les Vietnamiens atteignent une île au large de l’Indonésie. Ils se dirigent vers le rivage, coulent leur bateau – la même chose qu’à Singapour ne devrait pas leur arriver à nouveau. Les habitants les nourrissent et les aident à entrer en contact avec une organisation de réfugiés. Au bout d’un mois, un bateau vient chercher les Vietnamiens. Le père Dao contacte l’un de ses fils, qui travaille à Sursee chez un fabricant de vêtements.
Le matin du 9 avril 1980, les Dao débarquent à Zurich-Kloten, neuf mois après leur fuite. « De petites particules blanches flottaient dans l’air », raconte Trong Sang. Pour lui aussi, il s’agissait des premiers flocons de neige. Lui aussi dit : « Je n’oublierai jamais ce moment ».
« J’essaie de refouler beaucoup de choses ».

Une nouvelle vie pleine de reconnaissance
Trong Sang, aujourd’hui informaticien de gestion ES, est assis dans le jardin de sa maison familiale à Neudorf. À côté de lui, sa femme Xuan. « C’est la première fois que j’entends ton histoire de manière aussi détaillée », dit-elle. “J’essaie sans doute de refouler beaucoup de choses”, répond-il.
Mais il y a des jours et des nuits où il n’y arrive pas. La tête de Trong Sang se met alors à cogner. Aujourd’hui encore, il connaît par cœur les chansons de propagande et les slogans des communistes que lui ont inculqués ses professeurs au Vietnam. « Soudain, ces mélodies refont surface, tout comme les images de ma fuite ». Surtout maintenant, alors qu’il entend quotidiennement parler de réfugiés en bateau et de morts en Méditerranée. « Les réfugiés actuels ont le même destin que nous, les Vietnamiens, il y a bientôt 40 ans ». Mais lors de sa fuite, des familles isolées auraient organisé la traversée. « Par chance, je n’étais pas en route avec une bande de passeurs ».
Comme Xuan et Trong Sang Dao, des centaines de milliers de réfugiés vietnamiens sont dans la même situation. Par la mer ouverte, ces « boat people » cherchent un chemin loin du régime communiste – les experts estiment le nombre de réfugiés à 1,5 million. Souvent, les bateaux de pêche pourris n’atteignent pas les côtes.
On ne sait pas combien d’hommes, de femmes et d’enfants trouvent la mort en mer de Chine méridionale. Les experts estiment qu’ils sont un demi-million. « Je fais partie des chanceux et je suis infiniment reconnaissant », dit Trong Sang. « Dans ma famille, tout le monde a survécu. C’est rare ». Sa mère et sa grand-mère sont arrivées en Suisse cinq ans après lui au titre du regroupement familial. « Mon père a trouvé un emploi de menuisier au bout de trois mois et j’ai pu aller à l’école ». Sa famille a d’abord été « accueillie avec bienveillance » dans le foyer pour requérants d’asile de Menzingen, puis à Wolhusen et à Sursee, explique Trong Sang. « J’en suis infiniment reconnaissant à toutes les personnes et communes impliquées ».
A son arrivée, Xuan arrive à Emmenbrücke dans un centre d’accueil pour réfugiés, puis chez sa sœur à Littau. Aujourd’hui, elle est propriétaire d’une boutique de robes de mariée et de soirée à Reussbühl.
Entre 1978 et 1982, la Suisse a accueilli environ 10’000 réfugiés vietnamiens. Beaucoup d’entre eux sont catholiques. Au début des années 1980, ils se regroupent pour former la Mission vietnamienne suisse. Chaque semaine, ils célèbrent une messe en vietnamien.
Trong Sang et Xuan se marient et ont deux filles. Aujourd’hui, il dirige la chorale de la mission. Elle chante avec eux, les filles de 12 et 15 ans assistent aux cérémonies. « Nos enfants ne doivent pas oublier leurs racines », dit Xuan.
Le Vietnam – connu avant la guerre comme la perle de l’Orient – est aujourd’hui, même 40 ans après la fin de la guerre, une pure déliquescence, dit Xuan. « Le gouvernement est corrompu. Il n’y a pas de démocratie. La liberté d’expression ainsi que les droits de l’homme sont des mots étrangers dans ce pays ».