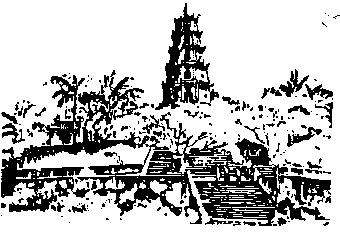
| A ces minorités s’ajoutent les Chams (environ 600’000) vivant dans la région de Nha Trang et de religion mulsumane, les Khmers (environ 700’000) répartis à l’Ouest du delta du Mékong. |
|
| Le Viêt Nam
est un pays d’une grande diversité géographique. Montagnes majestueuses et hauts
plateaux couverts de forêts; plaines du Nord et du Sud aux rizières inondées; côtes et
îles présentant de nombreuses baies, criques, falaises et plages. Au Viêt Nam, tout semble aller par trois: - trois régions historiquement marquées, le Nord, le Centre et le Sud, - auxquelles correspondent trois villes qui se ressemblent comme des soeurs mais cultivent leur caractère propre: la calme Hanoi, la cité des lacs et des arbres, la rêveuse et mélancolique Huê, dernière capitale impériale et Hô-Chi-Minh-Ville (Saigon), la moderne et l’industrielle, agitée et stressée, - et trois fleuves différents, respectivement: le Fleuve Rouge, la Rivière des Parfums et le Mékong. LE NORD Hanoi Bâtie sur la rive droite du Fleuve Rouge (Sông Hông), Hanoi possède une longue histoire. Les premiers Viêts s’installèrent dans cette région. En 1010, Ly Thai Tô vit un dragon d’or surgir d’un lac de la ville. Fort de ce présage heureux, il décida d’y transférer sa capitale et la renomma Thang Long (" Le dragon prenant son essor "). La ville changea encore plusieurs fois de nom et, en 1831, l’empereur Minh Mang lui donna son nom actuel qui signifie " en-deça " (nôi) " du fleuve " (ha). Ly Thai Tô fit construire des collines pour accueillir les génies protecteurs sur le conseil de ses géomanciens qui trouvaient le site trop plat pour être à l’abri des influences néfastes du Nord et une digue de 30 km, haute de 7 à 8 mètres pour protéger des crues. Au centre de la ville, la Cité impériale, cernée de hauts murs percés de portes aux quatre points cardinaux, abritant la Cité interdite, résidence de la famille impériale. Après une période de prospérité, le déclin arriva, renforcé lorsque les Nguyên établirent leur capitale à Huê. L’empereur Minh Mang, en 1820, excédé par le refus de reconnaître la nouvelle capitale impériale, la fit mettre à sac et transférer ses trésors à Huê. Aujourd’hui, Hanoi est une ville comportant plus de 3 millions d’habitants. L’âme de la ville survit dans la vieille ville du XVème siècle, la cité des " 36 rues et guildes " où les métiers qui s’y exerçaient et les produits qui s’y vendaient ont baptisé les rues. Telle Hang Dao (rue de la Soie), la principale artère. Les dinh (maisons communales) constituent l’un des charmes de la vieille ville: anciens temples de villages, lieux de réunions des notables en discussion sur les affaires communes et salles de fêtes et de banquets. Certains de ces bâtiments sur pilotis servent encore de lieu de culte, mais la plupart ont été transformés en écoles ou salles de réunion. Hanoi, la ville des lacs Hanoi c’est aussi la ville des lacs. Le Lac de l’Ouest (Hô Tây), le plus vaste, sur lequel circulent deux légendes: pour noyer le cruel renard blanc à neuf queues, le roi-Dragon du fleuve inonda la forêt, à moins que ce ne soit le Bufflon d’or qui, entendant l’énorme cloche du bonze Không Lô, pensa entendre l’appel de sa mère et vint de Chine, piétina la zone, donnant naissance au lac. Le Lac Truc Bach (Soie blanche), au bord duquel les concubines adultères ou disgraciées des seigneurs Trinh, emprisonnées dans un château, devaient tisser pour les princesses. Le Lac de l’Epée restituée (Hô Hoan Kiêm), au coeur de la vieille ville où, pour combattre les Ming, le futur empereur Lê Thai Tô reçut du génie du lac, une tortue d’or, une épée magique qu’il rendit après la victoire. " Le dragon descendant " (Ha Long) Quittant son antre dans la montagne, un dragon laissa de profondes empreintes dans le sol. Il plongea dans la mer qui déborda et envahit ces vallées. Les sommets des montagnes environnantes se transformèrent ainsi en milliers d’îlots. Hai Phong et la baie de Ha Long En 1872, les Français obtinrent une concession sur Hai Phong et firent de la ville le deuxième port du Viêt Nam (après Saigon) et un centre industriel important. Occupée par les Japonais pendant la seconde guerre mondiale et bombardée par les Français et les Américains, elle a surmonté ces périodes troubles. Des charmes parsèment ce port industriel: Edifices coloniaux, retour des pêcheurs et marché aux poissons agrémentent de port industriel. Surtout, à quelques kilomètres, s’ouvre la baie de Ha Long, qualifiée par certains de huitième merveille du monde. Sur 1550 km2 s’égrènent des myriades d’îles, îlots et récifs karstiques creusés de cavernes. Les sampans et les jonques glissent silencieusement dans ce paysage merveilleux peuplé de lieux aux noms poétiques: grottes du Pélican, de la Vierge, des Bouts de Bois, Rocher de la Poésie ... Les Hauts-Plateaux du Nord-Ouest Dans cette région peuplée de minorités ethniques se trouvent de nombreux villages charmants et des sites merveilleux. La Montagne des Parfums en est sans conteste l’un des plus beaux. Creusée de nombreuses grottes décorées de personnages peints sur la pierre, la montagne compte de multiples temples, pagodes et chapelles qui s’intègrent parfaitement à la nature luxuriante de l’endroit. Chaque printemps, de nombreux pèlerins remontent en sampan le cours de la Rivière Hirondelle puis escaladent à pied la montagne pour venir déposer leurs offrandes dans la Pagode des Parfums et son ensemble de temples bouddhistes. LE CENTRE Huê Siège d’une commanderie chinoise sous les Han, conquise au IIIème siècle par le royaume de Champa, sous contrôle vietnamien depuis le XIVème siècle, Huê fut le siège des seigneurs Nguyên. Lorsque l’un d’entre eux devint empereur du Viêt Nam, sous le nom de Gia Long, il y déplaça la capitale, anciennement à Hanoi. Occupation française, invasion japonaise lors de la deuxième guerre mondiale, guerre d’Indochine et guerre du Viêt Nam ont détruit massivement Huê. Elle a néanmoins pu conserver une part de son patrimoine. Sur la Rivière des Parfums (Sông Huong), Huê se divise en deux parties bien distinctes: sur la rive gauche, les restes de l’ancienne citadelle impériale et sur la rive droite, la ville nouvelle, longtemps refuge et lieu de rencontre de nombreux artistes, poètes et érudits, aux larges artères et aux villas coloniales. La cité impériale est construite sur le modèle de celle de Pékin: elle consiste en un grand carré fortifié. En son sein, la Cité pourpre interdite, demeure de la famille impériale, entourée d’une enceinte jaune (couleur impériale). De nombreux palais (en ruine ou encore debout) se présentent avec leurs noms poétiques: palais de la Paix Suprême, de la Grand-Mère, de la Splendeur, des Lois du Ciel, de la Perfection Céleste ... A quelques kilomètres de la ville se trouve le tertre de Nam Giao (terrasse du Sacrifice au Ciel et à la Terre). Dans ce lieu composé de deux terrasses carrées (la Terre), surmontées d’une terrasse circulaire (le Ciel), les empereurs Nguyên venaient rendre un culte au Ciel et à la Terre, après une nuit de jeûne dans le Palais de l’Abstinence. Un peu plus loin en remontant la Rivière des Parfums, les mausolées impériaux impressionnent par leur taille. Comprenant chacun une cour d’honneur, une Voie des Esprits gardée par des statues (éléphants, créatures fabuleuses, soldats ...), un Pavillon de la Stèle sur laquelle sont gravés les faits marquants de leur vie, ils se terminent par le tombeau à proprement parler, entouré de hauts murs et fermé de lourdes portes. Aujourd’hui encore, Huê demeure un haut lieu de la culture du Viêt Nam et invite à la poésie et à la rêverie dans ses très beaux jardins agrémentés de lacs, de collines artificielles, de bonsaïs et de fleurs. Au Nord de Huê De nombreux objets datant de l’âge du bronze (tambours, instruments de musique, statues, bijoux, outils ...) ont été découverts dans la région. Aujourd’hui y vivent d’importantes communautés montagnardes, surtout Muong. Ils ont conservé leur système d’écriture d’avant l’invasion chinoise qui présente des similitudes avec l’indien, le thaï et le laotien. Il comporte 30 signes consonantiques de base. C’est une région qui donna d’importants personnages historiques: berceau de la dynastie des Lê qui chassèrent les Chinois. Au Sud de Huê Au Sud de Huê, le Centre du Viêt Nam s’élargit. A la bande côtière, s’ajoutent de plus vastes espaces montagneux qu’au Nord de Huê. La variété de cette région en est renforcée. Au niveau des cultures, la diversité de la géographie se traduit par une richesse des produits cultivés ou exploités: cannelle, tabac, café, thé, arachide, soja, riz, coton, soie, sylviculture (hévéa, ébène, bois de rose, santal, etc.) et élevage de bétail. La région est surtout marquée par les nombreux vestiges laissés par l’ancien royaume du Champa (II-XVème siècle), parmi lesquels de magnifiques tours construites en briques qui dénotent de l’avance des techniques de construction. Un site d’importance, dans la vallée de My Son, centre religieux et culturel important où s’élevaient des temples destinés aux divinités brahmaniques dont Shiva, fondateur et gardien du Champa, fut malheureusement détruit en partie lors de la guerre du Viêt Nam. La zone côtière présente de nombreux ports. Hôi An en fut le plus grand sous les Nguyên. L’architecture de la ville est particulièrement intéressante: on peut y voir l’intégration des influences sino-japonaises au style local et de jolies maisons, construites sur deux niveaux, toutes en longueur, qui comportent toutes une boutique sur le devant. Lorsque Hôi An fut ensablée, Danang la surpassa définitivement. C’est là qu’accostèrent les colons espagnols puis français (XVII - XVIIIèmes siècles) et les premiers marines américains en 1965. A l’Ouest se situent de hauts plateaux boisés où vivent de nombreuses minorités ethniques qui ont échappé à toutes les tentatives d’acculturation des colonisateurs français comme du gouvernement vietnamien actuel. Au coeur de ces plateaux se trouve Dalat, station climatique touristique, charmeuse par ses hôtels rétros, ses villas coloniales et ses jardins de roses, géraniums, coquelicots, hibiscus et glaïeuls. LE SUD Saigon Petit comptoir commercial khmer, puis centre de négoce régional après un important afflux de commerçants chinois, Saigon est conquise par les Vietnamiens au XVIIIème siècle. Les Français y débarquent en 1859 et en font la capitale de la colonie de Cochinchine. Par la suite, elle sera capitale de la République du Viêt Nam et rebaptisée Hô-Chi-Minh-Ville après la réunification. Mais dans le coeur de ses habitants, la ville reste aujourd’hui encore Saigon. Architecturalement, la présence française a modifié la ville. De nombreux lieux en témoignent: hôtel de ville, poste centrale à la charpente de Gustave Eiffel, jardins zoologique et botanique ... Saigon est une véritable métropole commerciale animée. La présence d’une importante communauté chinoise, établie à Cholon (" Grand Marché "), la Chinatown de Saigon, où les marchés bruyants sont entourés de petits commerces et restaurants ouverts de jour et de nuit, renforce ce caractère commerçant. Saigon est aujourd’hui la capitale économique du pays. Le delta du Mékong Long de 4500 km, le Mékong débute son périple sur le plateau tibétain et traverse la Chine, la Birmanie, le Laos, le Cambodge puis le Viêt Nam, où il se sépare en neuf bras avant de se jeter dans la Mer de Chine, d’où son nom de Cuu Long (fleuve des neuf Dragons). Le delta du Mékong est une vaste zone traversée de ces multiples bras et affluents du Mékong. Territoire khmer avant l’arrivée des Vietnamiens, il constitue un grand marécage couvert de mangroves. Les seigneurs Nguyên les ont fait assécher et ont construit tout un réseau de canaux. Les alluvions déposées par le Mékong rendent cette région très fertile. Ainsi, elle est l’un des principaux grenier à riz du pays. Aux immenses rizières s’ajoutent de grandes plantations d’ananas, de manioc, de canne à sucre, des cocoteraies, des bananeraies, des vergers de mangues, de rambutans, de mandarines, de prunes et dans certaines régions de tabac, de soja et d’arachides. Dans les canaux, on procède à l’élevage de poissons d’eau douce. Les villages de pêcheurs au bord des canaux traversés de fragiles ponts de bambou qui ne conviennent guère aux Occidentaux, les marchés flottants sur certains bras ou canaux, la production artisanale de soie et bien d’autres éléments ajoutent encore au charme du delta du Mékong. Il reste aujourd’hui un fort pourcentage de Khmers, de Chams et de Chinois. D’autant plus que les massacres perpétrés par les Khmers rouges ont poussé de nombreux Cambodgiens à se réfugier dans cette région du Viêt Nam. Vung Tau (la Baie des Bateaux) L’ancien Cap Saint-Jacques des colons français est aujourd’hui un port de pêche très actif et le centre de l’industrie pétrolière du Viêt Nam, ce qui lui vaut le statut de zone économique spéciale partagé avec les îles Con Dâu, à 180 km au large, riches en bois précieux. Malgré un développement économique important, cette région a conservé tout son charme. On y trouve notamment une centaine de temples et de pagodes qui valent le détour, dont en particulier celle de Lang Ca Ong dédiée aux baleines, protectrices des pêcheurs. On peut y découvrir les squelettes de baleines échouées sur les côtes, conservés dans des châsses pouvant aller jusqu’à 4 mètres de long. Des grottes aux trésors Comme dans d’autres régions du Viêt Nam, les grottes sont ici des sanctuaires et portent des noms qui incitent au rêve ... La Grotte Dévoreuse de Nuages, à proximité de la ville de Ha Tiên, est un temple bouddhique composé de plusieurs salles et divers autels dont un dédié à l’Empereur de Jade. A l’entrée se trouve la Stèle de la Haine qui rend hommage à cent trente personnes massacrées en 1978 par les Khmers rouges de Pol Pot. |
| L’entrée de la Grotte de Chua Hang, située également à proximité de Ha Tiên, se trouve derrière l’autel d’une pagode bouddhique. La grotte contient la statue de Quan Am, Déesse de la Miséricorde et des stalactites creuses qui sonnent comme des cloches. |
|
|
buffle (annonciateur d’une bonne récolte) que d’un coq (mauvaise récolte), l’aboiement d’un chien (signe faste) que le hululement d’une chouette (épidémie et désastre). Il faut que le premier visiteur pénétrant dans la maison soit heureux et vertueux. Il ne s’agit pas de jurer, de casse du verre, de se mettre en colère, sous peine d’attirer les esprits malins. Il faut aussi éviter de balayer le sol pour ne pas chasser Thân Tai, le Dieu de la Richesse, qui se trouve peut-être là. |
| Aux premières
heures, les jeunes vont cueillir du lôc, rameaux symbolisant l’espoir et la chance.
Ils espèrent rencontrer la personne de leurs rêves. Ils rentrent ensuite composer le
premier poème de l’année. Les festivités ne s’arrêtent pas là. Le 2ème jour est réservé aux visites des proches et aux échanges de voeux. Le 3ème jour, on prend congé des ancêtres, le 4ème se déroule la cérémonie de l’ouverture des sceaux, réouverture de l’administration. Le 7ème jour enfin, les Tao Quân reviennent et les perches de bambou sont enlevées de devant les maisons. Les festivités du Têt durent ainsi environ deux semaines. Mais les foires et les kermesses peuvent se prolonger, jusqu’à la fin du même mois. |
|
Une fois recueillie, la résine est mise à décanter pendant plusieurs semaines. La couche supérieure, la meilleure, est ensuite mélangée à divers ingrédients et brassée une dizaine d’heures pour qu’elle épaississe. Mêlée à de la térébenthine, elle est rendue plus souple. |
| Les vietnamiens en Suisse Avant la séparation du pays en 1954, on ne dénombrait pratiquement pas de Vietnamiens en Suisse. Ce n’est qu’après les accords de Genève en 1954 qu’un petit nombre y fit son entrée. A partir de 1964 débarquèrent les étudiants qui, par tradition, s’expatriaient pour leurs études vers les pays francophones en Europe ou vers le Japon en Asie. A ce moment-là, le nombre de Vietnamiens en Suisse se chiffrait à 50 puis, en 1965, à 150 environ, tous concentrés autours des universités de Genève et de Lausanne. A partir de 1967-68, un certain nombre s’inscrivirent à l’université de Fribourg, le règlement universitaire obligeant alors les étudiants étrangers à y faire un séjour avant de pouvoir s’immatriculer ailleurs. Au début des années 70 débutèrent les programmes humanitaires en faveur des enfants vietnamiens, tels que le village Pestalozzi et Terre des Hommes, prenant en charge des orphelins ou infirmes. Au moment de la chute du Viêt Nam, à fin avril 1975, le nombre des Vietnamiens en Suisse s’élevait à plus de mille personnes, étudiants pour la grande majorité. Nombre des Vietnamiens résidant en Suisse entre 1984 et 1993: |
| 1984: 6’707 | 1989: 7’176 |
| 1985: 6’819 | 1990: 7’276 |
| 1986: 6’953 | 1991: 7’432 |
| 1987: 7’039 | 1992: 7’400 |
| 1988: 7’200 | 1993: 7’357 |
| En 1993, le nombre
total de la population asiatique en Suisse s’élevait à 50’756 (0.8%) sur
1’291’762 étrangers (19.3%), (population totale de la Suisse à cette époque:
6’696’000). Source: Office fédéral de la statistique. En 1975 déjà, la Suisse commença à accueillir des réfugiés vietnamiens ayant pris la fuite par la mer. Entre 1979 et 1984, on enregistra une forte augmentation due essentiellement à l’accord intervenu en 1979 entre le Haut-Commissariat pour les Réfugiés et les pays occidentaux, engageant ces derniers à accueillir environ 1 % de leur population. Il s’agissait surtout de Vietnamiens provenant des camps de réfugiés situés en Thailande et en Malaisie, par la suite des camps à Hongkong et aux Philippines, ainsi que de parents vietnamiens venus rejoindre la famille établie en Suisse dans le cadre de la réunification familiale. On peut donc constater que la Suisse dépassa confortablement son quota humanitaire de ce point de vue. Pays de mes rêves Pays lointain Patrie inconnue Terre qui a souffert (Hoang Thi Thuy-Co) Vers les années 90, on nota une diminution des Vietnamiens en Suisse, pouvant être expliquée par les naturalisations intervenues après douze ans environ de présence en Suisse. Vie associative Les associations d’étudiants d’antan se transformèrent en associations de réfugiés, principalement autour des villes universitaires romandes telles que Genève, Lausanne, Fribourg et Neuchâtel. Dès 1980, des associations de réfugiés vietnamiens furent également créées en Suisse alémanique comme par exemple à Zurich, Berne, Bâle, Lucerne et St. Gall. Alors que les anciennes Associations des étudiants vietnamiens de Genève et de Neuchâtel se transformèrent en Association des Vietnamiens libres de Suisse, celle des étudiants vietnamiens de Lausanne, créée en 1966, devint l’Association des Vietnamiens de Lausanne. A vocation sociale, elle se manifeste surtout lors de la fête du Têt qui réunit parfois jusqu’à mille personnes, grâce à la contribution d’une bonne centaine de volontaires plus ou moins impliqués durant plus d’un mois, et de la fête de la Mi-Automne destinée aux enfants. Elle organise également des cours de langue vietnamienne et possède, en outre, un club informatique, un bulletin d'information, ainsi qu’une équipe de football, de volleyball et de basketball.. Quant à la vie religieuse, on peut relever la présence du centre bouddhique Linh Phong à Ecublens qui coiffe toutes les activités de la religion bouddhiste dans les cantons de Vaud et de Genève, où la majorité des Vietnamiens sont bouddhistes. Les chrétiens sont tout aussi actifs avec, entre autres, à Lausanne, le père Huyên, ainsi que le pasteur Huân, qui célèbrent des messes et des cultes mensuels pour la communauté vietnamienne. Il en est de même dans les autres grandes villes de Suisse. Du côté des anciens militaires et prisonniers politiques, citons les activités de l'Association des vétérans et de son président Kinh qui a passé plus de dix ans dans les geôles du Sud au Nord. Il faut encore noter la très active Ligue vietnamienne des droits de l’homme. Du côté média, on trouve actuellement la revue "TAN VIET NAM" (le nouveau Viet Nam) éditer en langue vietnamienne avec des pages en langue allemande et française. |
|
|
| Vie
professionnelle De façon générale, on peut dire que les réfugiés vietnamiens sont assez bien intégrés dans la vie professionnelle en Suisse. Les enfants de la deuxième génération, nés en Suisse, ne rencontrent aucun problème quant à leur intégration scolaire, aussi bien en langue française qu’en langue allemande. Quant aux réfugiés établis en Suisse depuis quelques années, on constate une grande diversité professionnelle: professions de santé, enseignement, restauration, industrie, commerce, fonctionnatiat, PTT, CFF...Il existe même une association professionnelle: la Société interprofessionnelle vietnamienne dont le siège se trouve à Neuchâtel. Courant politique Ayant fui le régime communiste, les Vietnamiens restent attachés aux valeurs fondamentales des droits de l’homme et à leurs origines de réfugiés politiques, aspirant à un Viêt Nam libre et démocratique. Oeuvrant dans ce sens, le Comité Suisse-Viêtnam (Cosunam) et le Liên Minh VNTD (Alliance Viêtnam Liberté) ont pour objectif la démocratisation du Viêt Nam se basant sur les quatre principes: démocratie pluraliste, liberté et droits de l'homme, justice sociale, économie de marché. Trois générations de Vietnamiens en Suisse UNE: Faire quelque chose pour mon pays A 18 ans, L.N.Nguyen a débarqué en Suisse, comme bon nombre de ses compatriotes, pour y faire des études. C’était en 1970, année , où, au bénéfice d’une bourse de son pays, il se lance dans les sciences économiques et sociales à l’Université de Fribourg. Quatre ans plus tard, sa vie se précipite. A la fin du mois d’avril 1975, les troupes nord-vietnamiennes entrent dans Saigon, sa ville d’origine. Pour L.N.Nguyen, les projets de retour partent en fumée. " J’ai demandé le statut de réfugié politique et je l’ai obtenu ",raconte-t-il. Vingt ans plus tard, les choses ont bien changé, L.N.Nguyen est aujourd’hui titulaire d’un passeport rouge à croix blanche. Mais le passeport suffit-il à faire le moine ? A voir M.L.N.Nguyen, installé derrière son bureau de cadre à Lausanne , le doute n’est guère possible. M.L.N.Nguyen s’estime " complètement intégré " à son nouveau pays. Même si les débuts n’ont pas été toujours faciles. Aujourd’hui, L.N.Nguyen n’entend pas le moins du monde renier ses origines. Bien au contraire. Pour lui, les Vietnamiens installés en Suisse se sont presque trop bien fondus dans leur nouvelle vie. |
| " Nous, Vietnamiens, n’avons pas de problème d’intégration car nous sommes sur le même longueur d’ondes que les Suisses. Nous cultivons les mêmes valeurs de travail, de discipline, de famille. Et les Vietnamiens ne sont pas des gens sectaires, ils n’ont pas tellement tendance à se regrouper entre eux, à s’enfermer dans des ghettos. Résultat : nous tombons aussi parfois dans l’excès contraire. Les Vietnamiens de Suisse ont tendance à oublier leurs racines ", déplore-t-il |
|
| Pour y remédier,
L.N.Nguyen n’a d’autres moyens que de tenter, dans sa vie courante,
d’entretenir les traditions. Il ne rate ainsi jamais une occasion de parler
vietnamien en particulier à la maison. Pourtant, L.N.Nguyen- et bien d’autres Vietnamiens de Suisse avec lui- n’a qu’un rêve : retourner vivre au Vietnam et " faire quelque chose " pour son pays. " Mais dans le cadre d’un Etat de droit, d’un régime libéral et démocratique " précise-t-il. Pas question en outre de rentrer pour faire du business, "comme c’est le cas de beaucoup de Vietnamiens aujourd’hui, déplore-t-il. Un retour est-il vraiment possible après tant d’années passées en Suisse ? " Ce sera un choc, c’est sûr. J’ai vécu plus longtemps en Suisse qu’au Vietnam. Quant à mes enfants, nés en Suisse, ils n’ont jamais connu le Vietnam. L’idéal serait de trouver un travail qui me permette d’être 6 mois en Suisse, six mois au Vietnam ", lance -t-il Question : Vous critiquez le régime communiste
actuel et vous n’êtes jamais rentré au Vietnam . A l’heure de l’ouverture
économique et touristique effectuée par Hanoi, votre attitude n’est-elle pas
"ringarde" ? C’est une question de conscience personnelle et j’ai décidé, pour l’instant, de ne pas participer à cette ruée au Vietnam. Je me demande sincèrement comment la population juge certains " Viet-Kieu " d’outre-mer plein d’argent et de bonnes intentions...et qui repartent après des vacances à bon marché, pour une vie dorée à l’étranger DEUX: Le poids du passé Autre quartier, autre décor. V.K. Nguyen, 60 ans, nous accueille
dans son modeste mais propre appartement d’un quartier périphérique de Zurich. Une
table des ancêtres et de nombreuses photos de famille au Vietnam sont bien en vue dans le
salon.Sa femme est sagement assise à ses côtés, l’air très concentré. Elle
restera silencieuse pendant notre entretien se contentant de regarder son mari de temps à
autre. Ils n’ont pas grand-chose de commun avec les Vietnamiens de Suisse
d’avant 1975 comme L.N.Nguyen. Arrivés en Suisse en 1984, ils font partie de ces
fameux boat-people qui ont défrayé la chronique. " J’étais commandant dans
l’armée du Sud-Vietnam. Mon unité, une compagnie de parachutistes, a participé à
la bataille de Xuân-Lôc les derniers jours d’avril 1975. Nous nous sommes battus
par discipline et par désespoir alors que le président Thieu et la plupart de ses
généraux avaient déjà fui. " V.K.Nguyen a payé le prix cher de ce comportement:
il a passé quelques 8 ans dans les fameux camps de rééducation des " libérateurs
". C’est là qu’il a vu mourir d’épuisement et de privations la
plupart de ses meilleurs amis. Il en est sorti " brisé physiquement " et a fui
en bateau grâce à l’aide de parents. Deux mondes différents TROIS: Rencontre avec une jeune vietnamienne Nguyen T. vivant en Suisse depuis plus de dix ans. Actuellement, elle fréquente le collège Sismondi à Genève. Question : Quel âge avais-tu lorsque tu es arrivée en Suisse en 1982 ?Nguyen T. :J’avais 9 ans. Q.:Pour quelles raisons as-tu
quitté ton pays ? Mais surtout, notre vie était menacée par l’insécurité constante. Q.:Qu’entends-tu par
"insécurité " et peux-tu nous donner un exemple ? Q.:Quels sont tes souvenirs de
là-bas ? J’avais aussi une autre copine qui habitait à Saigon. Mais elle est morte car elle voulait être promue à la classe suivante. En effet, la condition de promotion était de ramener à la maîtresse le plus de métal possible que les élèves pouvaient ramasser dans la rue, n’importe où. Et elle, comme tant d’autres enfants, a trouvé la mort dans un terrain vague où il y avait encore des restes de bombes à retardement... Dans la ville où je vivait, les conditions de promotion étaient légèrement différentes : ramassage de papier. C’est ainsi qu’on voyait des enfants traîner dans les rues, fouiller dans des tas d’ordures, et même se disputer pour un morceau de papier. Il y en avait même qui déchiraient leurs cahiers, ainsi que ceux de leurs frères et soeurs pour ramener le tout à l’école. Et le titre de premier de classe revenait à celui qui avait le tas le plus lourd ... Q.:Comment est ta vie en Suisse
maintenant ? Q.: Est-ce que tu te sens intégrée
dans cette nouvelle vie en Suisse ? Q.: Qu’entends tu par là ? Q.: Quels sont tes rêves ? As-tu
des projets pour plus tard ? Q.: Penses-tu retourner dans ton
pays d’origine ? Q.: Qu’espères-tu y trouver ou
y retrouver ? Q.: As-tu des projets pour
l’avenir de ton pays ? |